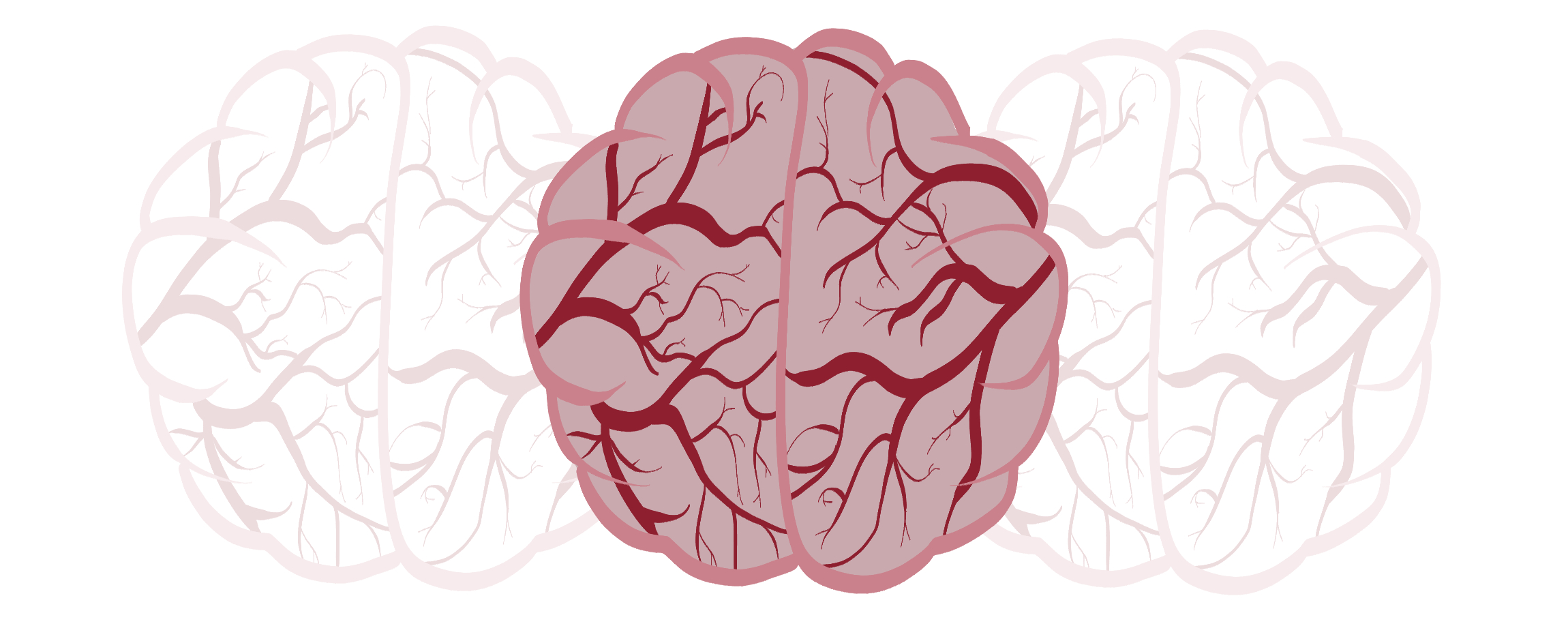
Les effets neurologiques du COVID
10 études scientifiques
Le SARS-CoV-2 a des effets reconnus au niveau neurologique, tant dans sa phase aigüe que longue. On sait aujourd’hui que l’infection par le virus modifie directement l’élasticité endothéliale, à l’origine de complications immédiates pouvant toucher le cerveau. Par ailleurs la persistance du virus dans cette zone a été montrée plusieurs fois, y compris récemment, par des chercheurs d’une équipe Pasteur (modèle animal), avec des marqueurs associés à des processus dégénératifs. De façon générale, l’impact du virus sur les capacités cognitives est documenté. Dans le cadre du COVID long, dont la sphère neurologique est très présente dans la symptomatologie, différents éléments pourraient contribuer au développement de maladies dégénératives, comme le rappelle le position paper de l’académie européenne de Neurologie appelant à une surveillance adéquate et à se préparer à un fardeau accru de ces maladies.
Voici un recueil d’études choisies sur cette sphère neurologique, à votre disposition pour consultation ou pour aider à faire reconnaitre l’intérêt du suivi neurologique après l’infection.
Sommaire
-
- La persistance de la protéine Spike au niveau de l’axe crâne-méninges-cerveau pourrait contribuer aux séquelles neurologiques de la COVID-19.
- Les hamsters atteints de COVID long présentent des profils transcriptomiques distincts associés à des processus neurodégénératifs dans le tronc cérébral.
- Cognition et mémoire après la Covid-19 dans un large échantillon communautaire.
- Modifications de la mémoire et de la cognition au cours de l’étude de l’étude “challenge humain SRAS-CoV-2”.
- Nécessité de sensibilisation et de surveillance des troubles neurodégénératifs post-COVID à long terme. Note de synthèse du groupe de travail NeuroCOVID-19 de l’Académie européenne de neurologie.
- Risque de troubles neuropsychiatriques et apparentés associés à l’infection par le SRAS-CoV-2 : une analyse des différences dans les différences.
- Hypoperfusion cérébrale chez des sujets souffrant de troubles cognitifs post-COVID-19 révélée par IRM avec marquage de spin artériel
- L’infection par le SRAS-CoV-2 et les fusogènes viraux provoquent une fusion neuronale et gliale qui compromet l’activité neuronale.
- La fibrine est à l’origine de la thromboinflammation et de la neuropathologie dans le contexte de la COVID-19.
- Association entre l’infection à la COVID-19 et l’apparition d’une démence chez les personnes âgées : revue systématique et méta-analyse.
1- La persistance de la protéine Spike au niveau de l’axe crâne-méninges-cerveau pourrait contribuer aux séquelles neurologiques de la COVID-19.
Cell Host & Microbe, décembre 2024 : lien.
Résultats marquants :
- La protéine Spike du SARS-CoV-2 persiste dans l’axe crâne-méninges-cerveau chez les patients atteints de COVID-19
- La protéine Spike suffit à induire des changements pathologiques et comportementaux dans le cerveau chez la souris
- La protéine Spike augmente la vulnérabilité du cerveau et exacerbe les lésions neurologiques chez la souris
- Les vaccins à ARNm réduisent, mais n’éliminent pas, la charge Spike
Résumé :
L’infection par le SARS-CoV-2 est associée à des symptômes neurologiques persistants, bien que les mécanismes sous-jacents restent flous. À l’aide de techniques d’éclaircissement optique et d’imagerie, nous avons observé une accumulation de la protéine Spike du SARS-CoV-2 dans l’axe crâne-méninges-cerveau de patients humains atteints de COVID-19, qui persistait longtemps après l’élimination du virus. De plus, les biomarqueurs de la neurodégénérescence étaient élevés dans le liquide céphalo-rachidien des patients atteints de COVID long, et l’analyse protéomique d’échantillons de crâne, de méninges et de cerveau humains a révélé des voies inflammatoires dérégulées et des changements associés à la neurodégénérescence. Des schémas de distribution similaires de la protéine Spike ont été observés chez des souris infectées par le SARS-CoV-2. L’injection de la protéine Spike seule a suffi à induire une neuroinflammation, des modifications protéomiques dans l’axe crâne-méninges-cerveau, un comportement de type anxieux et une aggravation des résultats dans des modèles murins d’accident vasculaire cérébral et de traumatisme crânien. La vaccination a réduit, mais n’a pas éliminé, l’accumulation de protéine Spike après l’infection chez les souris. Nos résultats suggèrent que la persistance de la protéine Spike aux frontières du cerveau pourrait contribuer aux séquelles neurologiques durables de la COVID-19.
2- Les hamsters atteints de COVID long présentent des profils transcriptomiques distincts associés à des processus neurodégénératifs dans le tronc cérébral.
Nature, juillet 2025 : lien.
Résumé :
Après avoir été infectés par le SARS-CoV-2, les patients peuvent présenter un ou plusieurs symptômes qui apparaissent ou persistent dans le temps. Les symptômes neurologiques associés au COVID long comprennent l’anxiété, la dépression et les troubles de la mémoire. Cependant, les mécanismes sous-jacents exacts ne sont pas encore entièrement compris. En utilisant des hamsters dorés comme modèle, nous apportons des preuves supplémentaires que le SARS-CoV-2 est neuro-invasif et peut infecter le cerveau de manière persistante, car l’ARN viral et le virus réplicatif sont détectés dans le tronc cérébral 80 jours après l’infection initiale. Les hamsters infectés présentent une signature neurodégénérative dans le tronc cérébral, caractérisée par une surexpression des gènes de l’immunité innée et une expression altérée des gènes impliqués dans les synapses dopaminergiques et glutamatergiques, dans le métabolisme énergétique et dans la protéostasie. Ces animaux infectés présentent un comportement dépressif persistant, des troubles de la mémoire à court terme et des signes d’anxiété tardifs. Enfin, nous fournissons des preuves que des mécanismes viraux et immunométaboliques coexistent dans le tronc cérébral des hamsters infectés par le SARS-CoV-2, contribuant à la manifestation de symptômes neuropsychiatriques et cognitifs.
3- Cognition et mémoire après la Covid-19 dans un large échantillon communautaire.
The New England Journal of Medicine, février 2024 : lien.
Contexte :
Les symptômes cognitifs après la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), sont bien connus. L’existence de déficits cognitifs objectivement mesurables et leur durée ne sont pas clairement établies.
Méthodes :
Nous avons invité 800 000 adultes participant à une étude en Angleterre à remplir une évaluation en ligne de leurs fonctions cognitives. Nous avons estimé un score cognitif global à partir de huit tâches. Nous avons émis l’hypothèse que les participants présentant des symptômes persistants (durant ≥ 12 semaines) après le début de l’infection auraient des déficits cognitifs globaux objectivement mesurables et que des troubles des fonctions exécutives et de la mémoire seraient observés chez ces participants, en particulier chez ceux qui ont récemment signalé des troubles de la mémoire ou des difficultés à réfléchir ou à se concentrer (« brouillard cérébral »).
Résultats :
Sur les 141 583 participants qui ont commencé l’évaluation cognitive en ligne, 112 964 l’ont terminée. Dans une analyse de régression multiple, les participants qui s’étaient rétablis de la Covid-19 et dont les symptômes avaient disparu en moins de 4 semaines ou au moins 12 semaines présentaient des déficits cognitifs globaux similaires à ceux du groupe non atteint de la Covid-19, qui n’avait pas été infecté par le SARS-CoV-2 ou dont l’infection n’avait pas été confirmée (−0,23 écart-type [intervalle de confiance {IC} à 95 %, −0,33 à −0,13] et −0,24 écart-type [IC à 95 %, −0,36 à −0,12], respectivement) ; des déficits plus importants par rapport au groupe non Covid-19 ont été observés chez les participants présentant des symptômes persistants non résolus (−0,42 écart-type ; IC à 95 %, −0,53 à −0,31). Des déficits plus importants ont été observés chez les participants qui avaient contracté le SARS-CoV-2 pendant les périodes où le virus d’origine ou le variant B.1.1.7 était prédominant que chez ceux infectés par des variants ultérieurs (par exemple, −0,17 écart-type pour le variant B.1.1.7 par rapport au variant B.1.1.529 ; IC à 95 %, −0,20 à −0,13) et chez les participants qui avaient été hospitalisés par rapport à ceux qui ne l’avaient pas été (par exemple, admission en unité de soins intensifs, −0,35 écart-type ; IC à 95 %, −0,49 à −0,20). Les résultats des analyses étaient similaires à ceux des analyses par appariement des scores de propension. Dans une comparaison entre le groupe présentant des symptômes persistants non résolus et le groupe sans Covid-19, les tâches liées à la mémoire, au raisonnement et aux fonctions exécutives étaient associées aux déficits les plus importants (−0,33 à −0,20 écart-type) ; ces tâches présentaient une faible corrélation avec les symptômes récents, notamment les troubles de la mémoire et le brouillard cérébral. Aucun effet indésirable n’a été signalé.
Conclusions :
Les participants dont les symptômes persistants après la Covid-19 avaient disparu présentaient des fonctions cognitives objectivement mesurées similaires à celles des participants présentant des symptômes de plus courte durée, bien que la Covid-19 de courte durée soit toujours associée à de légers déficits cognitifs après la guérison. La persistance à long terme des déficits cognitifs et leurs implications cliniques restent incertaines.
4- Modifications de la mémoire et de la cognition au cours de l’étude de l’étude “challenge humain SRAS-CoV-2”.
The Lancet, octobre 2024 : lien.
Contexte :
Les résultats rapportés par les patients et les données transversales montrent un lien entre la COVID-19 et des troubles cognitifs persistants. La causalité, la durée et la spécificité de ce lien restent floues en raison de la variabilité des capacités cognitives de base, des vulnérabilités, des variants du virus, du statut vaccinal et des traitements au sein de la population.
Méthodes :
Trente-quatre jeunes volontaires en bonne santé et séronégatifs ont été inoculés avec le SARS-CoV-2 de type sauvage dans des conditions contrôlées de manière prospective. Les volontaires ont effectué des mesures physiologiques quotidiennes et des tâches cognitives informatisées pendant la quarantaine et le suivi à 30, 90, 180, 270 et 360 jours. Une modélisation linéaire a permis d’examiner les différences entre les personnes « infectées » et celles « inoculées mais non infectées ». Le principal critère d’évaluation cognitif était le score composite cognitif global corrigé par rapport à la valeur de référence pour l’ensemble des tâches administrées aux volontaires. Les critères d’évaluation cognitifs exploratoires comprenaient les scores corrigés par rapport à la valeur de référence pour chaque tâche individuelle. L’étude a été enregistrée sur ClinicalTrials.gov sous le numéro d’identification NCT04865237 et s’est déroulée entre mars 2021 et juillet 2022.
Résultats :
Dix-huit volontaires ont développé une infection selon les critères qPCR de charge virale soutenue, l’un d’entre eux sans symptômes et les autres présentant des symptômes légers. Les volontaires infectés ont obtenu des scores cognitifs globaux composites corrigés par rapport à la valeur de référence statistiquement inférieurs à ceux des volontaires non infectés, tant au stade aigu que pendant le suivi (différence moyenne sur tous les points temporels = −0,8631, IC à 95 % = −1,3613, −0,3766) avec un effet principal significatif du groupe dans l’ANOVA à mesures répétées (F (1,34) = 7,58, p = 0,009). L’analyse de sensibilité a reproduit cette différence entre les groupes après contrôle de l’infection des voies respiratoires supérieures dans la communauté, de l’apprentissage des tâches, du traitement par remdesivir, de la référence de base et de la structure du modèle. Les tâches liées à la mémoire et aux fonctions exécutives ont montré les différences les plus importantes entre les groupes. Aucun volontaire n’a signalé de symptômes cognitifs subjectifs persistants.
Interprétation
Ces résultats corroborent les conclusions transversales plus larges indiquant qu’une infection légère par le SARS-CoV-2 de type sauvage peut être suivie de légers changements cognitifs et mnésiques qui persistent pendant au moins un an. La base mécanistique et les implications cliniques de ces légers changements restent floues.
5- Nécessité de sensibilisation et de surveillance des troubles neurodégénératifs post-COVID à long terme. Note de synthèse du groupe de travail NeuroCOVID-19 de l’Académie européenne de neurologie.
Springer Nature, mai 2025 : lien.
Contexte :
Des études neuropathologiques et cliniques suggèrent que l’infection par le SARS-CoV-2 pourrait augmenter le risque à long terme de neurodégénérescence.
Méthodes :
Nous présentons un aperçu narratif des observations pathologiques et cliniques justifiant la mise en place d’un programme de surveillance visant à suivre l’évolution de l’incidence des troubles neurodégénératifs dans les années suivant la COVID-19.
Résultats :
Les autopsies ont révélé divers changements dans le cerveau, notamment une perte d’intégrité vasculaire, des microthromboses, une gliose, une démyélinisation, des lésions neuronales et gliales et la mort cellulaire, tant chez les personnes non vaccinées que chez les personnes vaccinées, quelle que soit la gravité de la COVID-19. Des données récentes suggèrent que les microglies jouent un rôle important dans l’inflammation prolongée liée à la COVID-19, qui contribue à l’étiologie déclenchant une cascade neurodégénérative, à l’aggravation d’une maladie neurodégénérative préexistante ou à l’accélération des processus neurodégénératifs. Les données histopathologiques ont été corroborées par l’imagerie cérébrale, et des études épidémiologiques ont également suggéré un risque plus élevé de maladies neurodégénératives après la COVID-19.
Conclusions
En raison de la forte prévalence du COVID-19 pendant la pandémie, les systèmes de santé doivent être conscients et se préparer à une augmentation potentielle de l’incidence des maladies neurodégénératives dans les années à venir. Les stratégies peuvent inclure le suivi de cohortes bien décrites, l’analyse des résultats dans les registres COVID-19, des programmes de surveillance à l’échelle nationale utilisant le couplage des diagnostics CIM-10 et la comparaison de l’incidence des troubles neurodégénératifs dans les périodes post-pandémiques avec les valeurs des années pré-pandémiques. Une sensibilisation et une surveillance active sont particulièrement nécessaires, car les diverses manifestations cliniques dues à des infections antérieures par le SARS-CoV-2 pourraient ne plus être considérées comme des symptômes post-COVID-19, et par conséquent, l’augmentation de l’incidence des pathologies neurodégénératives au niveau communautaire pourrait passer inaperçue.
6- Risque de troubles neuropsychiatriques et apparentés associés à l’infection par le SRAS-CoV-2 : une analyse des différences dans les différences
Nature, juillet 2025 : lien.
Résumé :
La pandémie de COVID-19 a été associée à une augmentation des troubles neuropsychiatriques chez les enfants et les jeunes, des données suggérant que l’infection par le SARS-CoV-2 pourrait entraîner des risques supplémentaires au-delà des facteurs de stress liés à la pandémie. Cette étude vise à évaluer l’ensemble des troubles neuropsychiatriques chez les enfants (âgés de 5 à 12 ans) et les jeunes (âgés de 12 à 20 ans) positifs à la COVID-19 par rapport à une cohorte appariée négative à la COVID-19, en tenant compte des facteurs influençant le risque d’infection. À partir des données des dossiers médicaux électroniques de 25 établissements participant au programme RECOVER, nous avons mené une analyse rétrospective portant sur 326 074 participants positifs à la COVID-19 et 887 314 participants négatifs, appariés en fonction des facteurs de risque et stratifiés par âge. Les résultats neuropsychiatriques ont été examinés entre 28 et 179 jours après l’infection ou le test négatif, entre mars 2020 et décembre 2022. La positivité au SARS-CoV-2 est confirmée par PCR, sérologie ou tests antigéniques, tandis que la négativité nécessite des résultats de test négatifs et l’absence de diagnostics associés. Les différences de risque révèlent une fréquence plus élevée de troubles neuropsychiatriques dans la cohorte positive au COVID-19. Les enfants sont exposés à des risques accrus d’anxiété, de TOC, de TDAH, d’autisme et d’autres troubles, tandis que les jeunes présentent des risques élevés d’anxiété, de suicidalité, de dépression et de symptômes associés. Ces résultats soulignent que l’infection par le SARS-CoV-2 peut contribuer aux risques neuropsychiatriques, ce qui met en évidence l’importance de la recherche sur des traitements adaptés et des stratégies préventives pour les personnes touchées.
7- Hypoperfusion cérébrale chez des sujets souffrant de troubles cognitifs post-COVID-19 révélée par IRM avec marquage de spin artériel
Nature, avril 2023 : lien.
Résumé :
Les troubles cognitifs sont l’un des symptômes les plus courants de l’état post-SARS-CoV-2 (syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2), connu sous le nom de COVID long. Les techniques avancées d’imagerie cérébrale peuvent contribuer à une meilleure compréhension des changements physiopathologiques du cerveau et des mécanismes sous-jacents chez les sujets post-COVID-19. Notre objectif était d’étudier les altérations régionales de la perfusion cérébrale chez des sujets post-COVID-19 qui ont signalé une déficience cognitive subjective après une infection légère par le SARS-CoV-2, à l’aide d’une technique d’IRM non invasive appelée « Arterial Spin Labeling » (ASL) et d’une analyse. À l’aide du traitement d’images IRM-ASL, nous avons étudié les altérations de la perfusion cérébrale chez 24 patients (53,0 ± 14,5 ans, 15 femmes/9 hommes) présentant des troubles cognitifs persistants après la COVID-19. Des analyses voxel par voxel et par région d’intérêt ont été réalisées afin d’identifier les différences statistiquement significatives dans les cartes du débit sanguin cérébral (CBF) entre les patients post-COVID-19 et les témoins sains appariés en fonction de l’âge et du sexe (54,8 ± 9,1 ans, 13 femmes/9 hommes). Les résultats ont montré une hypoperfusion significative dans un réseau cérébral étendu chez le groupe post-COVID-19, affectant principalement le cortex frontal, ainsi que le cortex pariétal et temporal, comme l’a identifié un test de permutation non paramétrique (p < 0,05, corrigé par FWE avec TFCE). Les zones d’hypoperfusion identifiées dans les régions de l’hémisphère droit étaient plus étendues. Ces résultats corroborent l’hypothèse d’un dysfonctionnement important du réseau chez les sujets post-COVID présentant des troubles cognitifs. La nature non invasive de la méthode ASL-IRM pourrait jouer un rôle important dans le suivi et le pronostic des sujets post-COVID-19.
8- L’infection par le SRAS-CoV-2 et les fusogènes viraux provoquent une fusion neuronale et gliale qui compromet l’activité neuronale.
PubMed, juin 2023 : lien.
Résumé :
De nombreux virus utilisent des molécules de surface spécialisées appelées fusogènes pour pénétrer dans les cellules hôtes. Bon nombre de ces virus, dont le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), peuvent infecter le cerveau et sont associés à des symptômes neurologiques graves par le biais de mécanismes mal compris. Nous montrons que l’infection par le SARS-CoV-2 induit une fusion entre les neurones et entre les neurones et les cellules gliales dans les organoïdes cérébraux de souris et d’humains. Nous révélons que cela est causé par le fusogène viral, car il est entièrement imité par l’expression de la protéine Spike (S) du SARS-CoV-2 ou du fusogène p15 non apparenté provenant de l’orthoréovirus du babouin. Nous démontrons que la fusion neuronale est un événement progressif, qui conduit à la formation de syncytiums multicellulaires et provoque la propagation de grosses molécules et d’organites. Enfin, à l’aide de l’imagerie Ca2+, nous montrons que la fusion compromet gravement l’activité neuronale. Ces résultats fournissent des informations mécanistiques sur la manière dont le SARS-CoV-2 et d’autres virus affectent le système nerveux, altèrent son fonctionnement et provoquent des neuropathologies.
9- La fibrine est à l’origine de la thromboinflammation et de la neuropathologie dans le contexte de la COVID-19
Nature, août 2024 : lien.
Résumé :
Les événements thrombotiques potentiellement mortels et les symptômes neurologiques sont fréquents dans les cas de COVID-19 et persistent chez les patients atteints de COVID long qui souffrent de séquelles post-aiguës de l’infection par le SARS-CoV-21,2,3,4. Malgré les preuves cliniques1,5,6,7, les mécanismes sous-jacents de la coagulopathie dans les cas de COVID-19 et ses conséquences sur l’inflammation et la neuropathologie restent mal compris et les options thérapeutiques sont insuffisantes. Le fibrinogène, composant structurel central des caillots sanguins, est abondamment déposé dans les poumons et le cerveau des patients atteints de COVID-19, est corrélé à la gravité de la maladie et constitue un biomarqueur prédictif des déficits cognitifs post-COVID-191,5,8,9,10. Nous montrons ici que la fibrine se lie à la protéine Spike du SARS-CoV-2, formant des caillots sanguins pro-inflammatoires qui entraînent une thrombo-inflammation systémique et une neuropathologie dans le COVID-19. La fibrine, agissant par le biais de son domaine inflammatoire, est nécessaire au stress oxydatif et à l’activation des macrophages dans les poumons, tandis qu’elle supprime les cellules tueuses naturelles après une infection par le SARS-CoV-2. La fibrine favorise la neuroinflammation et la perte neuronale après l’infection, ainsi que l’activation immunitaire innée dans le cerveau et les poumons, indépendamment de l’infection active.
10-Association entre l’infection à la COVID-19 et l’apparition d’une démence chez les personnes âgées : revue systématique et méta-analyse
BMC Geriatrics, décembre 2024 : lien.
Résumé
Contexte
Le lien entre l’infection au COVID-19 et une éventuelle augmentation du risque de développer une démence nouvellement apparue (DNA) chez les personnes âgées reste difficile à cerner.
Méthodes
Une recherche approfondie a été effectuée dans plusieurs bases de données, notamment MEDLINE/PubMed, PsycINFO, Scopus, medRxiv et PQDT Global, afin de recenser les études publiées en anglais entre janvier 2020 et décembre 2023. Seules les études originales explorant le lien entre l’infection au COVID-19 et la DNA ont été sélectionnées. Nous avons évalué le risque de développer une DNA à l’aide du rapport de risque (RR). Les groupes témoins ont été classés comme suit : (i) une cohorte non COVID présentant d’autres infections respiratoires [groupe témoin (C1)] ; et (ii) une cohorte non COVID dont l’état de santé n’était pas précisé [groupe témoin (C2)]. Les périodes de suivi ont été divisées en intervalles de 3, 6, 12 et 24 mois après la COVID.
Résultats
Onze études (portant sur 939 824 survivants de la COVID-19 et 6 765 117 témoins) ont été incluses dans la revue. Sur une période d’observation médiane de 12 mois après la COVID, l’incidence globale de la DNA était d’environ 1,82 % dans le groupe infecté par la COVID, contre 0,35 % dans le groupe non infecté par la COVID. La méta-analyse globale a montré une augmentation significative du risque de DNA chez les survivants âgés de la COVID-19 par rapport aux témoins non atteints de la COVID-19 (RR = 1,58, IC à 95 % : 1,21-2,08). Une augmentation similaire du risque de DNA a été observée dans les analyses de sous-groupes limitées à une période d’observation de 12 mois (RR = 1,56, IC à 95 % : 1,21-2,01), ainsi que dans cinq études qui ont utilisé l’appariement par score de propension pour contrôler de manière suffisante et efficace les multiples covariables confondantes (RR = 1,46, IC à 95 % : 1,10-1,94). Le groupe COVID-19 et le groupe C1 partageaient un risque comparativement accru de développer une DNA (RR global = 1,13, IC à 95 % : 0,92-1,38).
Discussion
Dans des circonstances normales, nous pensons que l’infection par la COVID-19 est susceptible d’être un facteur de risque de développer une DNA chez les personnes âgées au fil du temps. Bien que l’augmentation du risque de DNA due à l’infection par la COVID-19 semble similaire à celle associée à d’autres infections respiratoires, elle justifie et nécessite des recherches avec des observations à plus long terme.
Sources et articles rassemblés par l’association Winslow Santé Publique – septembre 2025.
Traductions avec DeepL.com (version gratuite).