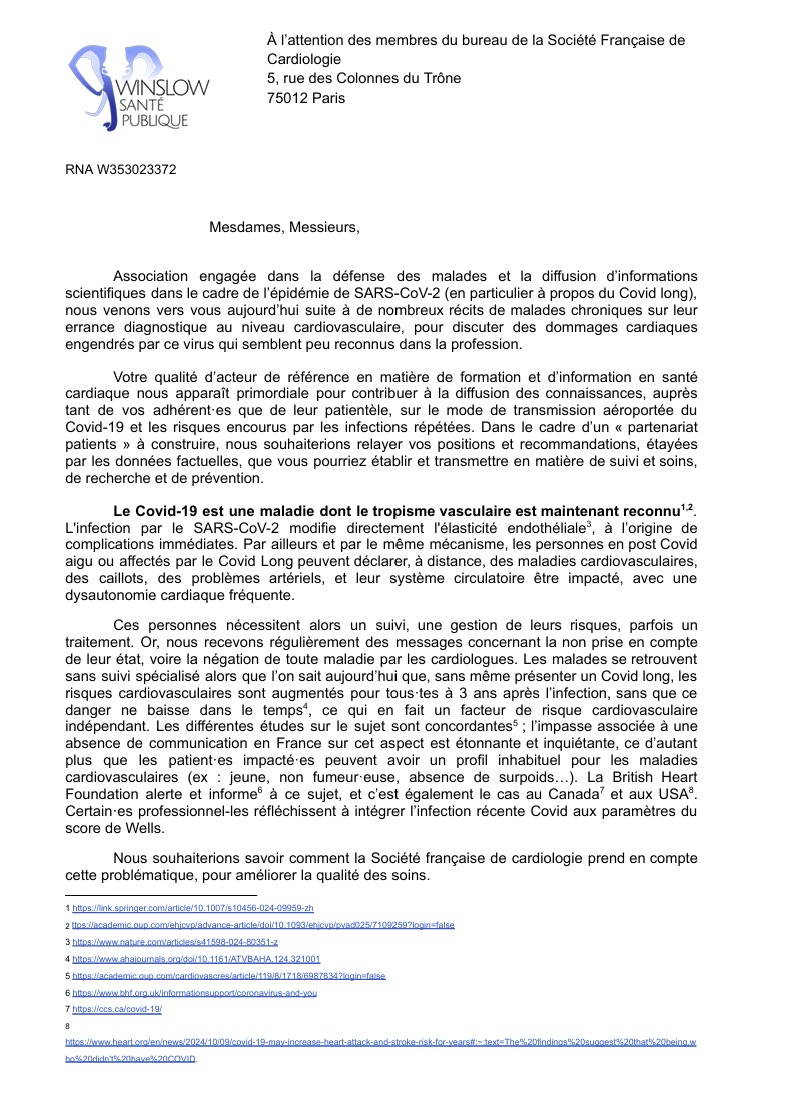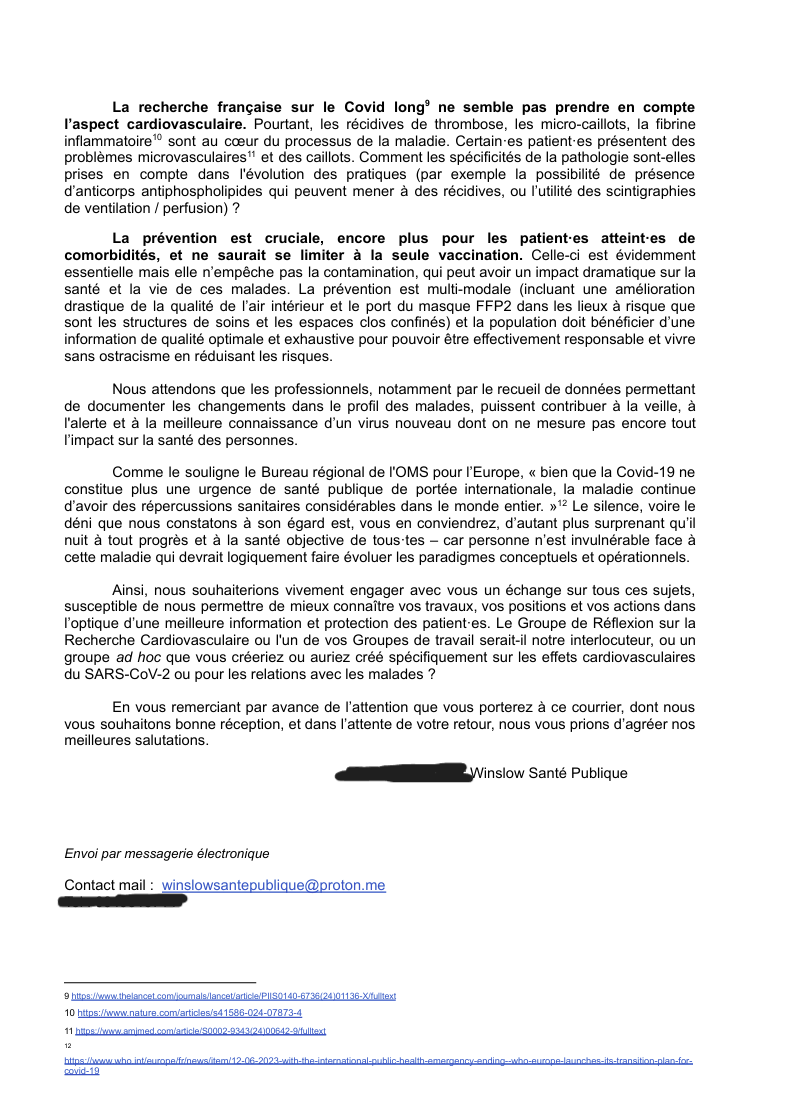Courrier envoyé aux membres du bureau de la Société Française de Cardiologie (10 février 2025)

Mesdames, Messieurs,
Association engagée dans la défense des malades et la diffusion d’informations scientifiques dans le cadre de l’épidémie de SARS-CoV-2 (en particulier à propos du Covid long), nous venons vers vous aujourd’hui suite à de nombreux récits de malades chroniques sur leur errance diagnostique au niveau cardiovasculaire, pour discuter des dommages cardiaques engendrés par ce virus qui semblent peu reconnus dans la profession.
Votre qualité d’acteur de référence en matière de formation et d’information en santé cardiaque nous apparaît primordiale pour contribuer à la diffusion des connaissances, auprès tant de vos adhérent·es que de leur patientèle, sur le mode de transmission aéroportée du Covid-19 et les risques encourus par les infections répétées. Dans le cadre d’un « partenariat patients » à construire, nous souhaiterions relayer vos positions et recommandations, étayées par les données factuelles, que vous pourriez établir et transmettre en matière de suivi et soins, de recherche et de prévention.
Le Covid-19 est une maladie dont le tropisme vasculaire est maintenant reconnu (1, 2). L’infection par le SARS-CoV-2 modifie directement l’élasticité endothéliale (3), à l’origine de complications immédiates. Par ailleurs et par le même mécanisme, les personnes en post Covid aigu ou affectés par le Covid Long peuvent déclarer, à distance, des maladies cardiovasculaires, des caillots, des problèmes artériels, et leur système circulatoire être impacté, avec une dysautonomie cardiaque fréquente.
Ces personnes nécessitent alors un suivi, une gestion de leurs risques, parfois un traitement. Or, nous recevons régulièrement des messages concernant la non prise en compte de leur état, voire la négation de toute maladie par les cardiologues. Les malades se retrouvent sans suivi spécialisé alors que l’on sait aujourd’hui que, sans même présenter un Covid long, les risques cardiovasculaires sont augmentés pour tous·tes à 3 ans après l’infection, sans que ce danger ne baisse dans le temps (4), ce qui en fait un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Les différentes études sur le sujet sont concordantes (5); l’impasse associée à une absence de communication en France sur cet aspect est étonnante et inquiétante, ce d’autant plus que les patient·es impacté·es peuvent avoir un profil inhabituel pour les maladies cardiovasculaires (ex : jeune, non fumeur·euse, absence de surpoids…). La British Heart Foundation alerte et informe (6) à ce sujet, et c’est également le cas au Canada (7) et aux USA (8). Certain·es professionnel-les réfléchissent à intégrer l’infection récente Covid aux paramètres du score de Wells.
Nous souhaiterions savoir comment la Société française de cardiologie prend en compte cette problématique, pour améliorer la qualité des soins.
La recherche française sur le Covid long (9) ne semble pas prendre en compte l’aspect cardiovasculaire. Pourtant, les récidives de thrombose, les micro-caillots, la fibrine inflammatoire (10) sont au cœur du processus de la maladie. Certain·es patient·es présentent des problèmes microvasculaires (11) et des caillots. Comment les spécificités de la pathologie sont-elles prises en compte dans l’évolution des pratiques (par exemple la possibilité de présence d’anticorps antiphospholipides qui peuvent mener à des récidives, ou l’utilité des scintigraphies de ventilation / perfusion) ?
La prévention est cruciale, encore plus pour les patient·es atteint·es de comorbidités, et ne saurait se limiter à la seule vaccination. Celle-ci est évidemment essentielle mais elle n’empêche pas la contamination, qui peut avoir un impact dramatique sur la santé et la vie de ces malades. La prévention est multi-modale (incluant une amélioration drastique de la qualité de l’air intérieur et le port du masque FFP2 dans les lieux à risque que sont les structures de soins et les espaces clos confinés) et la population doit bénéficier d’une information de qualité optimale et exhaustive pour pouvoir être effectivement responsable et vivre sans ostracisme en réduisant les risques.
Nous attendons que les professionnels, notamment par le recueil de données permettant de documenter les changements dans le profil des malades, puissent contribuer à la veille, à l’alerte et à la meilleure connaissance d’un virus nouveau dont on ne mesure pas encore tout l’impact sur la santé des personnes.
Comme le souligne le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, « bien que la Covid-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, la maladie continue d’avoir des répercussions sanitaires considérables dans le monde entier. » (12) Le silence, voire le déni que nous constatons à son égard est, vous en conviendrez, d’autant plus surprenant qu’il nuit à tout progrès et à la santé objective de tous·tes – car personne n’est invulnérable face à cette maladie qui devrait logiquement faire évoluer les paradigmes conceptuels et opérationnels.
Ainsi, nous souhaiterions vivement engager avec vous un échange sur tous ces sujets, susceptible de nous permettre de mieux connaître vos travaux, vos positions et vos actions dans l’optique d’une meilleure information et protection des patient·es. Le Groupe de Réflexion sur la Recherche Cardiovasculaire ou l’un de vos Groupes de travail serait-il notre interlocuteur, ou un groupe ad hoc que vous créeriez ou auriez créé spécifiquement sur les effets cardiovasculaires du SARS-CoV-2 ou pour les relations avec les malades ?
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier, dont nous vous souhaitons bonne réception, et dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations.
xxxx, pour l’association Winslow Santé Publique
Retrouvez un recueil d’études sur le sujet sur notre site : https://winslow.fr/douze-etudes-scientifiques/
Image du courrier original ci-dessous: