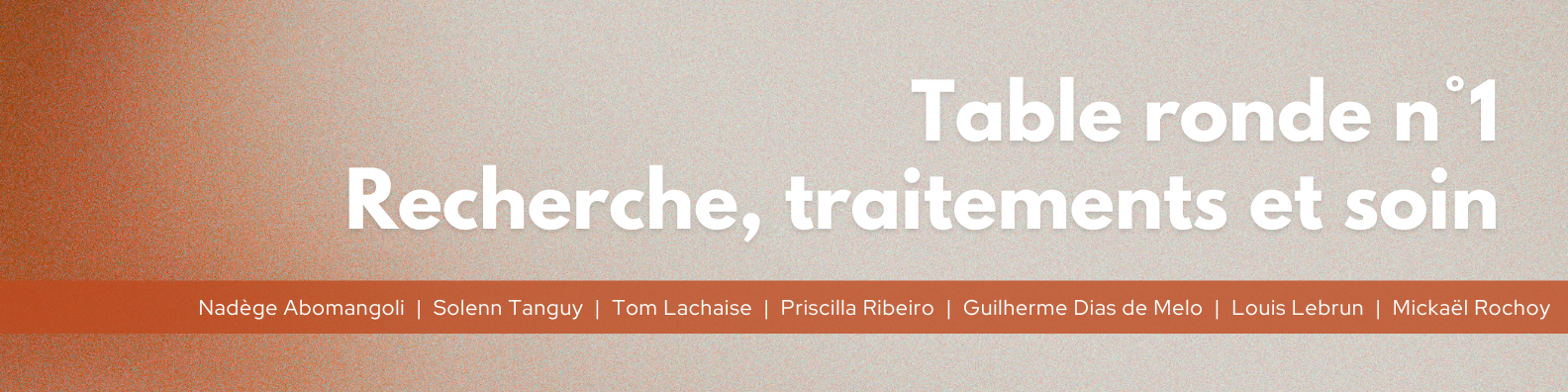
Modératrice : Nadège Abomangoli, députée et Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale
IntervenantEs :
● Solenn Tanguy, Présidente de Winslow Santé Publique
● Tom Lachaise, membre d’AprèsJ20
● Priscilla Ribeiro, Présidente de Covid Long Solidarité
● Guilherme Dias de Melo, chercheur à l’Institut Pasteur sur le COVID Long
● Louis Lebrun, médecin de Santé Publique
● Mickaël Rochoy, médecin généraliste
Début de la table ronde n°1 (vidéo) : 17:50
Retranscription
Tom Lachaise souligne le fait que la tenue d’un tel colloque sur le COVID Long en 2025 est quelque chose d’assez exceptionnel car le combat contre le COVID Long est de plus en plus invisibilisé. Il rappelle que certains malades souffrent depuis 5 ans maintenant et sont gaslightés par le système de santé et les médecins. Surtout, les vagues de COVID continuent de s’enchainer même si elles ne font plus la une des médias. Il donne des chiffres sur le coût économique du COVID Long pour la France qui est estimé à 0,5-1% du
PIB soit 15 à 30 milliards/an (Source : The Economist). Malgré la gravité de la situation, rien n’est fait : les centres experts COVID Long ferment les uns après les autres, aucun traitement n’est développé en France, seule la rééducation est proposée aux malades : “Un pansement sur une jambe amputée.”
Il décrit trois leviers qui pourraient être activés selon lui :
- Publication des décrets d’application de la loi Zumkeller de 2022 pour recenser les personnes vivant avec le COVID Long, les visibiliser et rationaliser les parcours de soin sur tout le territoire, mais aussi trouver des candidatEs pour les projets de recherche.
- La reconnaissance en ALD et en congés longue durée puisqu’il n’y a toujours pas de traitements et que les gens continuent de souffrir et de tomber dans la précarité : “Il faut permettre aux gens de survivre malgré leurs symptômes très invalidants.”
- Réactiver le réseau de centres experts COVID Long, favoriser la collaboration et le partage d’informations entre médecins qui s’intéressent à cette maladie, notamment pour donner des médicaments hors AMM comme cela est fait dans d’autres pays.
Il explique que mettre en place ces leviers coûterait de l’argent, mais moins que le coût économique annuel du COVID Long lié aux pertes de productivité, arrêts maladies, pertes d’emploi… La France doit rattraper son retard en allouant son argent là où il soigne réellement plutôt que dans des cures thermales qui coûtent 250 millions d’euros et épinglées par la Cour des Comptes pour leur absence d’efficacité d’un point de vue médical.
Priscilla Ribeiro rappelle l’ampleur et la gravité du COVID Long chez les enfants, ainsi que le manque de formation des médecins et de l’Éducation Nationale sur le sujet. Elle dénonce la prise en charge actuelle des enfants vivant avec le COVID Long qui est encore pire que celle des adultes : pénurie de certains spécialistes en France (orthophonistes), parcours du combattant pour obtenir un diagnostic mais aussi pour construire un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), etc.
Gabriel Dias de Melo confirme que le COVID Long est une maladie reconnue au début par les patients eux-mêmes. Il explique qu’au début de la crise, l’ensemble des chercheurs et chercheuses qui le pouvaient se sont réorienté vers la recherche sur le COVID. Mais au fur et à mesure qu’on a mieux contenu collectivement le COVID aigu, la recherche sur les conséquences à long terme est devenue de plus en plus difficile. Il rappelle aussi que la définition du COVID Long est complexe car beaucoup de systèmes d’organes peuvent être atteints : “Pour définir une maladie, il faut que l’on trouve une cause, quelque chose qui explique le déséquilibre.”
Selon lui, il y a une forte probabilité que la persistance virale soit une cause importante du COVID Long et il y a donc beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais également sur l’inflammation et la dérégulation de l’immunité. Du point de vue de la recherche, il souligne l’importance d’avoir des chercheurs et chercheuses investiEs sur le sujet ce qui implique d’avoir budget dédié COVID Long. Et c’est possible et faisable à condition que patients, chercheurs et pouvoirs politiques travaillent ensemble : “On ne peut pas aller plus vite que la recherche.” Il faut prendre le temps de comprendre et de déchiffrer pourquoi les symptômes du COVID Long persistent. Pour finir, il insiste également sur le risque que le COVID Long devienne une maladie négligée comme tant d’autres et donc qu’il est nécessaire de continuer de parler du COVID Long en tant que sujet de recherche et de santé publique.
S. Tanguy exige un grand plan de recherche sur le COVID Long, avec un budget dédié et
aussi un plan d’action centré sur les causes et les mécanismes de la maladie. Elle dénonce l’orientation de nombreuses recherches sur la psychologie et la personnalité des malades : “Le problème ce n’est pas les gens, le problème c’est le pathogène.” Elle s’inquiète également d’une certaine tendance de la recherche à transformer les malades en bases de données ambulantes, avec des études qui s’arrêtent une fois les données récoltées et sans avancées significatives derrière à part des compléments alimentaires. Les sujets de recherches doivent aussi porter sur la maximisation de l’espérance de vie des personnes vivant avec le COVID Long, encore plus quand on sait que les enfants sont aussi touchés par la maladie. Elle déplore que rien ne soit fait aujourd’hui pour monitorer les risques et complications de la maladie et souligne l’importance de former les médecins spécialistes car iels ne connaissent pas les spécificités du COVID Long.
N. Abomangoli interroge la table sur le rapport des COVID Long avec le corps médical et comment se déroule le diagnostic de la maladie aujourd’hui en France. Les différentes associations s’accordent sur le fait que c’est un véritable parcours du combattant. Les malades sont obligés de s’auto-diagnostiquer à partir de leur vécu et des connaissances accumulées. Pour les enfants c’est pire du fait de capacités d’expression plus limitées. Le diagnostic met trop de temps à arriver et les malades sont souvent psychologisés et forcés à retourner à l’école ou au travail. Pourtant, les associations rappellent que les examens/outils de diagnostic COVID Long existent déjà et sont directement corrélés aux symptômes, mais ils ne sont pas déployés.
Pour Louis Lebrun, le COVID et le COVID Long constituent un défi pour la société à bien des égards. Il développe un parallèle avec la crise du Mediator : face aux malades qui déclenchaient des valvulopathies liées à la prise de ce médicament, les cardiologues avaient tendance à vouloir les mettre dans les cases déjà connues (rhumatisme articulaire aigüe dans l’enfance). Il explique que c’est souvent ce qu’il se passe quand un phénomène nouveau bouscule les paradigmes et certitudes scientifiques, et que c’est aussi le cas pour le COVID. Exemple : on sait aujourd’hui que le virus du COVID n’est pas manuporté mais aéroporté. Mais le changement de paradigme est difficile à faire car des décisions politiques ont été prises sur ces bases maintenant dépassées . Pour les politiques et les personnes en situation de responsabilité, il est très difficile d’admettre s’être trompé. Il y aussi de façon générale une tendance à vouloir oublier les problèmes en les niant et les minimisant, surtout quand le problème concerne la partie de la population “qui n’est pas aux manettes”. Selon lui, peut-être que lorsque les dirigeants seront eux-mêmes confrontés au problème, les solutions arriveront plus rapidement. La crise COVID a en tout cas révélé le validisme de la société. Une fois le pic passé, on se retrouve dans une situation où ce sont les personnes directement concernées qui doivent se battre contre l’invisibilisation. Cela lui rappelle le cas du SIDA.
Louis Lebrun évoque le cas des chercheurs qui doivent avoir les moyens de chercher pas
uniquement sur les sujets les plus mainstreams. Il insiste sur le fait que la recherche sur le COVID Long profitera à tout le monde. Il constate également que depuis le début de la crise COVID, une tendance se dégage : les gens sont davantage malades, mais comme on ne dépiste plus, on ne comprend pas pourquoi. La prise de conscience sur le sujet se fera également parce qu’on aura réussi à convaincre les bonnes personnes aux endroits clés. La formation des médecins est importante et il faut aussi continuer de mettre le sujet du COVID Long dans le débat public comme avec ce colloque.
N. Abomangoli interroge les intervenantEs sur l’état de la situation en France concernant les essais cliniques COVID Long, notamment en comparaison avec les autres pays européens. Elle demande par quoi est-ce qu’il faudrait commencer et comment mettre en œuvre une politique globale pour traiter le COVID Long ?
G. Dias de Melo rappelle la variabilité de la définition d’un essai clinique et que plusieurs essais sont en cours dans différents pays notamment sur des antiviraux (Paxlovid). Selon lui, la problématique principale c’est déjà de comprendre le virus et la maladie, car sans cela on ne peut pas savoir quels traitements développer ou tester. Par exemple, on sait que le virus du COVID se cache à différents endroits dans le corps humain mais si c’est à bas bruit c’est à dire sans réplication virale forte, un traitement antiviral aura du mal à agir. Il estime que prendre n’importe quelle molécule pour faire des essais cliniques n’est pas forcément la marche à suivre et qu’il faut trouver des marqueurs pour le diagnostic de la maladie et ses mécanismes, ce qui aiguillerait sur les molécules à tester. Il insiste sur le fait que pour traiter les patients, le diagnostic est primordial car sans diagnostic, pas de prise en charge. Il faut soigner les symptômes mais aussi le malade dans son ensemble, en tant que COVID Long. Il y a une définition du COVID Long et les médecins doivent l’appliquer. Pour cela il faut une démarche active pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde.
T. Lachaise est d’accord sur la nécessité de comprendre en profondeur les mécanismes de la maladie mais pour lui il n’y a pas besoin de tout comprendre pour lancer des essais cliniques. Il estime que la France est particulièrement conservatrice sur les essais cliniques contrairement à d’autres pays qui testent des choses pour soulager les malades. En 2023, la France investissait ainsi 15 centimes par habitant sur la recherche contre le COVID Long soit beaucoup moins qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. La France est aussi en retard sur la médiatisation du COVID Long. Pour finir, il présente une plateforme construite par AprèsJ20 pour recenser le nombre d’essais cliniques dans le monde : il y a actuellement 550 essais cliniques dans le monde mais seulement 4 en France.
Mickaël Rochoy expose les enjeux posés par le COVID Long pour les médecins généralistes :
1) Reconnaître la maladie (comme cela a été plusieurs fois rappelé par les différentEs intervenantEs).
2) Intégrer la maladie dans la pratique des médecins généralistes. Il rappelle qu’unE médecin généraliste fait environ 5000 actes par an et qu’il y a environ 50000 médecins généralistes en France. La problématique du COVID Long vient donc s’ajouter à un moment où il y a déjà une pénurie de médecins. Pour lui, il faut donc libérer du temps aux médecins, notamment par la prévention qui permet d’éviter d’augmenter le nombre de malades et ne pas surcharger les médecins. Il donne des chiffres sur la prévalence du COVID Long : 4 à 5% de la population, ce qui est déjà énorme pour lui. Il explique ensuite que pour les personnes avec une forme de
COVID Long peu invalidante, le diagnostic va être plus difficile, mais que pour les personnes avec une forme de COVID Long très invalidante (Malaises post-effort, tachycardie…), il est difficile de les louper car même si un médecin généraliste passe à côté, il y a de grandes chances que les malades passent à un moment ou un autre par les urgences, voient un spécialiste… Le diagnostic COVID Long sera donc posé tôt ou tard mais s’il reste la question de la prise en charge.
interventions du public :
- Une femme vivant avec le COVID Long rebondit sur la question du temps de la recherche et du temps vécu par les malades. Elle rappelle qu’il y a une définition du COVID Long par l’OMS depuis en 2020 et qu’on est en 2025. Même si elle a conscience que la recherche prend du temps, elle appelle aussi les chercheurs et politiques à entendre l’urgence des malades et de leurs vies complètement chamboulées (erte parfois totale d’autonomie, suicides…) : “On a trop attendu pour des essais thérapeutiques”. Elle raconte ensuite un épisode qui s’est déroulé lors de la dernière journée de recherche de l’ANRS sur le COVID Long où des chercheurs s’interrogeaient sur le bien fondé de proposer une ponction lombaire à des COVID Long du fait de la douleur : “Il faut se réveiller, les COVID Long souffrent tous les jours, ont des douleurs insoutenables. Si on leur propose des ponctions lombaires pour faire avancer la recherche, il y aura la queue jusqu’au bout de la rue.”
- G. Dias de Melo rappelle qu’on ne sait toujours pas le nombre exact de personnes vivant avec le COVID Long en France. Le recensement des malades est très important pour dimensionner les forces à allouer au problème. Il faut un état des lieux sur le sujet.
- Pietro Tome, représentant de l’ASFC (Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique), explique que selon lui les questions posées depuis 5 ans par le COVID Long se poseraient déjà depuis 60 ans pour les malades EM qui vivent la psychiatrisation, l’absence de prise en charge, la minimisation de leur maladie. Il évoque un courrier fait par l’ASFC en 2020 et envoyé à la Directrice de la HAS mais aussi au Président de la République pour les mettre en garde sur ce qui allait se produire avec la crise COVID, notamment l’apparition de COVID Long et d’EM. Il déplore que ces mises en garde n’aient pas été écoutées et rappelle que dans la formation des médecins, il n’y a toujours qu’une ligne dans leur parcours sur l’EM et les Syndrome Post-Infectieux (SPI), qui en plus fait référence à de la psychosomatisation et de la psychiatrisation. Il raconte ensuite que depuis 5 ans, certains médecins connus ont inondé les médecins généralistes et internistes de fascicules pour faire reconnaître le COVID Long comme une maladie psychiatrique et psychosomatique, ce qui a rendu particulièrement difficile la reconnaissance du COVID Long comme une vraie maladie. Il appelle à une convergence des luttes et à n’invisibiliser aucune personne touchée par SPI (Lyme long, mononucléose…). Enfin, il finit par une question sur les centres de références : « Où en est-on de l’ouverture de centres de référence autres que CASPER en Île-de-France ? »
- S. Tanguy explique que Winslow Santé Publique a commencé à faire des choses contre CASPER. Elle est aussi d’accord sur le constat que de nombreuses maladies ont été pendant longtemps ou sont toujours invisibilisées et minimisées (EM, sclérose en plaques, etc.). Elle explique aussi que pour obtenir des résultats, il faut absolument éviter de mixer les recherches notamment en construisant des cohortes mélangées de plusieurs maladies. Elle insiste sur le fait que chaque maladie dont l’EM a le droit à sa reconnaissance, à son nom propre et à sa recherche dédiée. Cela n’empêche pas selon elle de faire des liens et des recoupements en fonction de certains symptômes mais qu’il faut garder en tête qu’un même symptôme peut avoir des causes différentes. Elle cite notamment l’exemple des maladies auto-immunes qui ont pour beaucoup un listing de symptômes similaires au COVID Long. Elle appelle donc à faire de la recherche rigoureuse qui permette ensuite de faire profiter à tous les malades de ce qui sera trouvé ou pas.
- Pour G. Dias de Melo, il faut absolument comprendre les mécanismes spécifiques du COVID Long : “Il y a sûrement des mécanismes communs à d’autres maladies mais on ne peut pas tout mélanger.”
- Isabelle, représentante de l’association Covid Long Enfant revient sur le COVID Long pédiatrique. Elle met en avant le fait que les enfants COVID Long ne pourront pas aller sur le marché du travail, qu’ils vivent avec des dommage au coeur, cerveau, poumons… et auront donc besoin de soins sur le long terme qui vont peser lourdement sur notre système de santé, notamment d’un point de vue économique. Elle appelle donc à mettre l’accent sur le COVID Long pédiatrique car les enfants représentent l’avenir de notre pays. Elle mentionne l’existence d’études internationales qui donnent déjà des ordres de grandeur sur la prévalence de la maladie chez les enfants et insiste sur le fait n’y a pas de raisons que ce soit très différent chez nous : “Comme Tchernobyl, cela ne s’est pas arrêté à la frontière.” Elle rappelle également que ces chiffres sont déjà inquiétants alors même que dans les écoles, les réinfections continuent. Elle dénonce la psychiatrisation des enfants et des ados qui est encore pire que pour les adultes. Pour finir, elle souligne l’importance de travailler en lien avec l’Éducation Nationale, notamment sur les questions de poursuite de la scolarité, de signalements abusifs d’enfants malades pour absences scolaires.
- Un homme vivant avec le COVID Long s’adresse au chercheur de l’Institut Pasteur au sujet de la faisabilité d’une collaboration internationale sur les recherches contre le COVID Long, qui permettrait notamment de sortir d’un fonctionnement en silos qui amène par exemple la France à redécouvrir des choses déjà découvertes depuis longtemps ailleurs comme des traitements.
- Une femme vivant avec le COVID Long et ancienne infirmière demande pourquoi il n’y a pas de guide comme en Suisse pour aider les médecins à diagnostiquer le COVID Long et écouter réellement les malades. Elle propose que ce guide soit construit avec les ARS. Elle explique qu’il faut aussi dégager du temps pour que les médecins généralistes se forment car ils sont le point de départ de la prise en charge des malades et n’ont souvent pas envie de se former.
- Nora Sahara, journaliste, travaille actuellement sur un livre enquête sur le COVID Long. Elle interroge la salle sur l’existence d’un éventuel phénomène d’abandon par les malades de la médecine traditionnelle au profit des médecines “alternatives”, phénomène qui serait une porte ouverte aux dérives.
- Pour S. Tanguy il y a plusieurs raisons qui expliquent l’abandon du système de soin traditionnel par les malades et la plus inquiétante et la plus massive est effectivement le poids des médecines “alternatives”. Elle explique que lorsqu’il n’y a pas de traitements et que les médecins psychologisent, les malades sont vite happés par ces “alternatives”. Encore plus avec le COVID Long puisque les mouvements antivax complotistes comme Réinfocovid se sont reconvertis dans la désinformation sur le COVID Long et la vente de solutions miracles. Elle témoigne aussi du fait que de nombreux malades sortent du système de santé traditionnel parce qu’ils sont fatigués après plusieurs années de mise en danger dans les lieux de soin (risque de réinfection par l’absence de mesures de réduction des risques) et par le combat permanent avec le médecin pour faire reconnaître leurs besoins et la réalité de leur maladie. Elle dénonce également la tendance de certains médecins à encourager les “médecines alternatives”, phénomène qui éloigne notamment les patients de la vaccination et du soin de manière générale.
- Aurélie Larmurier, médecin psychiatre et membre de la plateforme normande d’éducation thérapeutique, fait la pub pour des ateliers mis au point par sa structure pour « quand même proposer des choses aux COVID Long malgré l’absence de traitements ».
- S. Tanguy explique que beaucoup de personnes vivant avec un COVID Long au sein de Winslow Santé Publique n’iront pas dans ce type d’ateliers d’éducation thérapeutique car les malades en organisent déjà en mieux dans leurs assos. Elle insiste sur le fait que depuis 5 ans, c’est dans les associations que les malades ont trouvé le meilleur soutien, les meilleurs conseils et ont pu alerter sur les risques de complications (MPE, embolies…) dans les parcours thérapeutiques proposés par certains médecins. Les malades ne souhaitent pas être institutionnalisés et voir leur savoir expérientiel dévoyé par certains médecins : « Tant qu’il n’y aura pas de gestion de complications, on n’ira pas. »